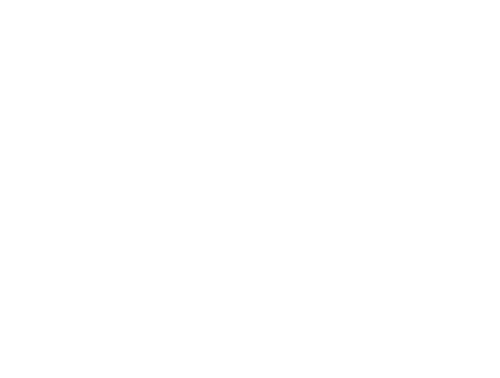J’ai découvert la littérature espagnole à travers des histoires, mais je n’en retiens qu’une et elle n’est même pas espagnole. Quand j’étais tout petit, quand j’avais trois ou quatre ans en 2003 ou 2004, je suis allé dans la chambre de mon grand-père ; dans l’ombre, il m’a parlé du comte Dracula et de son majordome Anselmo —jamais Igor—, qui vivaient en Transylvanie, une région espagnole. Je pourrais essayer de classer l’histoire avec quelque système sur la morphologie du folklore, mais cette histoire n’avait aucun élément narratif : elle n’a jamais abouti à rien, il n’y a pas eu de développement, rien n’a interrompu le cours ordinaire des choses. Le comte Dracula a appelé son majordome Anselmo. « Anselme, Anselme ! La seule chose pertinente était l’intonation et sa capacité à me faire rire avec une seule blague répétée presque tous les après-midi. C’était une histoire comme aurait pu l’être le rituel d’acheter une petite sucette au lait l’après-midi dans le parc.
Cette histoire a encore quelque chose d’espagnol pour moi, j’insiste, parce que mon grand-père me l’a racontée ; Peu importe le comte ou ses origines, l’événement raconté. Chez moi, il n’y avait pas de lecture. A chaque fois que je le dis, je tombe nez à nez avec l’incrédulité des autres : une bande d’interlocuteurs pour qui il est inconcevable que moi, qui écris des livres et m’y consacre largement, vienne d’un foyer sans étagères ni dos par centaines. Je ne me renierai pas avec surprise, car je connais l’envie qui m’envahit chaque fois que je visite la maison de quelqu’un qui a bien reçu un héritage ; Je parcours des collections habitées, je les touche avec mes doigts, j’aperçois leurs traces ou morceaux de vie. Les miens n’étaient pas des poèmes tendrement récités dans un jardin ou sur un balcon ; J’ai d’abord lu la multitude de lectures pour enfants, obligatoires à l’école ; la collection d’El Barco de Vapor et son escargot détective La littérature espagnole était la et, par conséquent, un objet presque mythique. Viendraient alors l’anglophilie —étonnamment, d’une francisation— et le discrédit : j’ai dévoré l’anglais sonore plus que l’espagnol, tellement atavique et curriculaire. Je vivais dans des fantasmes comme tous les adolescents.
Je ne sais pas à quel moment précis la philosophie et la littérature espagnoles se sont mêlées, mais je sais qu’elles se sont plus ou moins rapprochées. Je pense que les poèmes sont venus en premier. J’ai lu Miguel Hernández avec intérêt et, « ma langue lente et longue est déjà un cœur, / mon cœur est déjà une langue longue et lente », ou politisé, j’ai cherché du sens dans le ; J’ai été ému par le bruit triste que font les corps quand ils s’aiment, parce que les mains non plus ne pleuvent pas comme on dit; J’ai lu Lorca, j’ai lu Pizarnik, j’ai acheté la poésie de San Juan de la Cruz éditée par Cátedra à El Rastro de Madrid et des dizaines d’autres livres. J’aimais profondément Gil de Biedma. C’est une éducation, me dis-je parfois, formidablement scolaire. Parce que mon introduction à ces livres a toujours été l’école, la seule porte ouverte disponible ; Je ne sais pas si je vis quelque chose comme ça avec appréciation ou mépris, avec le savoir que procure la sociologie de la littérature que j’ai ouvertement découverte, sachant que jamais dans ma biographie il n’y eut de rencontres fortuites, de livres de parents ouverts par hasard, préférences exprimées par des parents très instruits. Dans les maisons de Plasencia où j’ai vécu enfant, la seule personne intéressée par les livres, c’était moi, et le rythme de ma lecture était régi par le programme établi par les institutions. Je me vantais de toujours gagner à l’école quand il était temps de concourir pour les vitesses de lecture, comme si en lisant plus vite j’allais être plus intelligent, absorber plus, me distinguer avec quelque chose qui m’appartenait ou transformer la littérature en refuge, en foyer. Je ne peux pas m’empêcher de regarder par-dessus mon épaule quelqu’un qui désigne une lecture du programme scolaire du secondaire comme l’un de ses livres préférés, mais j’étais cette fille qui admirait, qui admirait Unamuno parce qu’elle ne savait rien d’autre, qui vraiment lu l’obligatoire parce que le monde ne lui était pas encore ouvert.
La prochaine chose que je sais, c’est l’accélération et la découverte du contemporain qui m’est venue presque en lisant ceux qui plus tard, dans des virages absurdes de la vie, deviendront mes pairs. Maintenant, quand je vais à des festivals et que je rencontre un écrivain, que je me lie d’amitié avec lui, et que je sais que je n’ai encore rien lu de lui, alors j’accède à la personne avant d’accéder au texte, l’ombre d’un embarras de classe se profile, d’un travail en retard que je dois livrer prochainement. J’ai toujours détesté avoir des idoles, mais comme il est rare de rencontrer des noms. Aujourd’hui j’admire ceux de ma génération qui sont déjà collègues et parfois je ne sais pas si je les aime plus pour leur amour ou pour leur travail : Gonzalo Torné, Cristina Morales, Berta García Faet, Sara Barquinero. Qu’est-ce qui les amènera à penser de moi, qui n’ai pas lu, que je suis un interlocuteur ? Comment ne pas se sentir étranger dans un monde auquel on n’arrive pas par droit d’appartenance ? Je voudrais toujours transmettre l’étincelle de la découverte de soi dans un monde auquel on accède comme un intrus. La littérature espagnole, moi, une fille de 2000, de l’intérieur, voudrais toujours la contempler comme une fête dans laquelle tous les cœurs s’ouvrent.
Abonnez-vous pour continuer à lire
lire sans limites