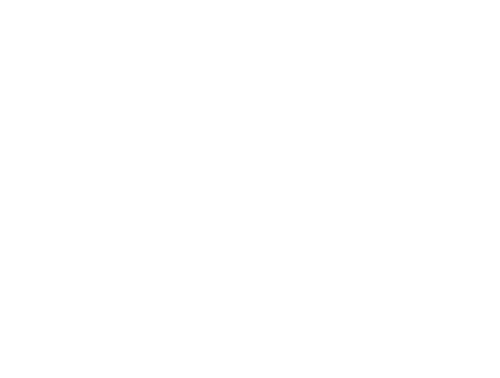Avez-vous déjà été victime de violence de genre ? Vous êtes-vous sentie discriminée ou harcelée dans votre rôle de leadership parce que vous êtes une femme ? Je propose ces questions pour réfléchir ensemble à la prise de conscience des enjeux de genre.
Dans mon cas, j’ai dit – et je le répète – que ce n’est pas parce que je suis une femme que je suis en mesure de répondre de manière adéquate à ces questions. J’avoue qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour développer une conscience de genre dans ma vie et qu’à plusieurs reprises j’ai déçu d’autres femmes qui, dans un public, attendaient de ma part des réponses inspirantes, claires et énergiques sur le sujet.
Je ne vais donc pas concentrer cette méditation sur la nécessité d’avancer dans l’éradication de la violence de genre, une cause sans doute urgente et moralement et éthiquement obligatoire. Mon intérêt dans cet espace est de réfléchir au manque d’éducation et de sensibilité dont nous disposons pour comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons de genre.
Je suis une femme et je me reconnais comme telle. Depuis toute petite, lorsqu’on m’interroge sur mon sexe, je n’ai jamais douté. J’ai grandi dans une maison de six enfants, dont cinq filles ; J’ai fait mes études dans une école religieuse pour femmes ; et je ne me suis jamais interrogée – et je n’ai pas non plus bénéficié d’un soutien éducatif en la matière – sur les différentes perceptions du genre, ni sur les fardeaux historiques, sociaux et culturels du fait d’être une femme. J’ai grandi dans une ignorance audacieuse, sans questions majeures. Cette naïveté m’a sûrement rendu franc et audacieux à la fois, car, en ne me remettant pas en question sur le sujet, je ne la ressentais pas, par principe, comme une barrière.
J’ai vécu mon université entourée de blagues comme « Ici les femmes sont MMC (pendant que je me marie) », signifiant qu’on continuerait seulement à étudier ; Le harcèlement en classe ou les expressions sexistes n’étaient pas un sujet de réflexion. Nous étions pleins d’erreurs, même s’il faut l’admettre non seulement dans ce domaine mais dans de nombreux aspects de la vie de cette époque. Tout cela s’est traduit par un monde très tolérant à l’égard de la violence sociale, psychologique et physique contre les femmes. Juger les femmes sur la façon dont elles s’habillent, détruire leur réputation, plaisanter sur leurs capacités et leur intelligence et même, dans des cas plus graves, ignorer les mauvais traitements et les abus.
Je dois aussi avouer que lorsqu’on m’a demandé si j’avais été harcelé ou maltraité au travail, j’ai dû répondre oui, que, comme au temps des sorcières, je me suis senti brûlé, en l’occurrence au feu de la réputation. On vous accuse d’être la fille, l’épouse ou l’amante d’un homme important pour justifier vos mérites. Même, à plusieurs reprises, j’ai vu ma sécurité compromise en ne sachant pas que dans notre société une femme seule dans un lieu, à certaines heures, semble afficher un panneau « Disponible et intéressé », perdant presque le droit de dire « NON ».
Bulletin
L’analyse de l’actualité et les meilleures histoires de Colombie, chaque semaine dans votre boîte mail
RECEVEZ LE
Mais peut-être que le plus complexe dans toute cette affaire est de ne pas m’en être rendu compte au moment où cela m’arrivait. Je l’ai toujours attribué au fait d’être plus jeune que les autres, de ne pas faire partie des élites ou, tout simplement, d’avoir, mais en aucun cas au fait d’être une femme.
Je n’ai compris le poids du genre que lorsque j’ai rencontré d’autres femmes qui m’ont fait voir dans leurs histoires une répétition des miennes ; un chemin plus difficile que la normale. À l’approche de la quarantaine, j’ai commencé à m’interroger sur les préjugés cognitifs et culturels liés au fait d’être une femme. J’ai pris conscience des stéréotypes et de la façon dont nous les nourrissons tous, j’ai appris ce qu’étaient les plafonds de verre, les sols collants et le syndrome de l’imposteur.
Puis je suis devenue féministe avant tout pour moi et par moi. Savoir aussi comprendre les combats des femmes qui m’ont précédé et quelle est ma responsabilité auprès des plus jeunes à qui j’ouvre les portes avec mes propres recherches. J’ai trouvé l’engagement éthique en tant que femme au-delà de l’être, c’est-à-dire que je me sentais appelée à avoir ma propre voix qui représentait celle des autres femmes. Une voix qui ne me laisserait pas hésiter lorsqu’on me demanderait ce que je ressens d’être le premier recteur de l’université que je dirige, et qui me permettrait de dire combien il est important et puissant de faire partie d’un groupe de femmes que nous dirigeons dans monde d’aujourd’hui, des transformations éducatives avec une nouvelle sensibilité, et avec la grande tâche de proposer de nouvelles conversations pour élargir le spectre de pensée et d’action de l’éducation.
C’est ainsi que j’ai appris et continue d’apprendre la valeur d’être une femme et comment, depuis ma place, je peux contribuer à la construction d’une société plus consciente, qui se permet de philosopher, c’est-à-dire de questionner, d’être émerveillé et réfléchit à ce que signifie parler de genre.
Je crois qu’il est de notre responsabilité de créer une sensibilité collective, il est nécessaire d’éduquer dans des environnements sûrs autour du genre, de la diversité et de l’inclusion. Une sensibilité qui nous guide dans la construction de protocoles pour accompagner et faire face aux situations génératrices de violence de genre, notamment en milieu scolaire et universitaire ; et cela, surtout, nous oblige à penser et repenser ce que nous disons et faisons pour identifier les préjugés intellectuels et culturels, avec l’idée de s’éloigner des histoires uniques qui éliminent la diversité des voix et des perspectives, et qui perpétuent la violence associée à l’exclusion et une vision simpliste de la vie.
_